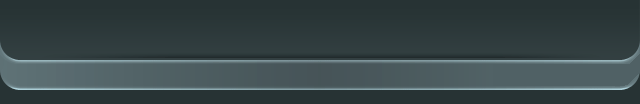L'oeuvre complète établie par le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou
Robert MALLET-STEVENS, l’œuvre
complète…
QUELQUES
NOTICES D’ŒUVRES EXTRAITES DU CATALOGUE
«ROBERT
MALLET-STEVENS, L’ŒUVRE COMPLÈTE»
(extraits
du dossier de presse réalisé à l’occasion de l’exposition rétrospective présentée
du 27 avril au 29 août 2005 au Centre Pompidou – toutes les notices du
dossier de presse ne sont pas reprises)

Portrait
de Robert Mallet-Stevens, vers 1924.
Photo
D.R. / Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens
/ © ADAGP, 2004, Paris
Pour toutes les photographies de cette page : © ADAGP, 2004, Paris
CHÂTEAU
DE M. PAUL POIRET, MÉZY, 1921-1923
Au début
des années 1920, le couturier Paul Poiret1 fait l’acquisition d’un vaste terrain dans les Yvelines pour
y installer sa résidence principale, destinée à accueillir sa retraite future.
«Entre Paris et le Havre, un mur d’argile et de craie accompagne la Seine à
travers tous ses méandres capricieux. Cette crête blanche et rocheuse est
couronnée, en maintes places, par un bois hirsute, à l’abri duquel j’ai assis
ma fière maison, en aval de Meulan, au-dessus d’un petit pays accroché à flanc
de coteau qu’on appelle Mézy2.»
Quel
architecte pour Mézy ? Avant-guerre, Paul Poiret a déjà sollicité Louis
Süe, qui avait installé en 1909 les salons du couturier avenue d’Antin. En
1916-1917, il a fait appel à Le Corbusier pour une villa destinée à sa famille,
située à Bormes-les-Mimosas et restée à l’état d’esquisse. En pourparlers avec
Auguste Perret3, le couturier choisira finalement Robert Mallet-Stevens,
peu de temps avant que ce dernier ne commence le projet pour Charles de
Noailles. Est-ce au sein des cercles d’artistes décorateurs que Poiret a
rencontré Mallet-Stevens – qui jusqu’alors n’avait jamais construit –, ou dans
le milieu des cinéastes modernes que fréquentait l’architecte ?
Dans ses
mémoires, Paul Poiret ne donne pas beaucoup de détails sur le programme de son
château. On sait peu de choses de ses attentes : pas d’usage
professionnel, mais une maison à la campagne pour une famille de trois
enfants ; en limite de la propriété, la maison du gardien, couplée au
garage ; plus loin, la demeure, calée sur un socle saillant.
Mallet-Stevens l’organise horizontalement autour d’un patio, au fond duquel se
trouve l’entrée. À l’ouest, l’aile des services adossée à la pente regroupe sur
deux niveaux la cuisine, la «salle des gens» et les six chambres des
domestiques. Dominant la vallée de la Seine, les espaces de réception occupent
l’équerre sud-est du plan : la salle à manger, et le hall en double
hauteur, qui structure l’ensemble du bâtiment et s’articule avec l’escalier
principal et le vestibule ‘entrée. Puis vient la galerie, sorte de salon
intime. En prolongement de l’aile est se trouvent, successivement, les appartements
de Monsieur (bureau et chambre) et ceux de Madame (chambre et boudoir à
l’extrémité est de la maison). Au premier étage, les chambres d’amis –
autonomes, grâce à un escalier extérieur –, et les chambres des enfants se
partagent les espaces de part et d’autre du vide formé par la double hauteur du
hall. Au-dessus de ce dernier, la tour de la cage d’escalier se prolonge vers
un troisième niveau et donne accès à un belvédère abrité sous un auvent, depuis
lequel le regard porte jusqu’à Paris.
Le
chantier débute en 1922. En juin 1923, alors que seul le gros œuvre est
terminé, Le Bulletin de la vie artistique fait état de l’arrêt du
chantier et du devenir incertain du projet. Il déplore «qu’un amateur illustre
ait pu ajourner la continuation du véritable château moderne qu’élevait pour
lui, non loin de Paris, M. Rob Mallet-Stevens4 ». Fin 1926, Paul Poiret étant en
faillite, Mallet-Stevens publie les photographies du bâtiment inachevé dans les
Cahiers d’art5, puis en 1927 dans L’Architecture vivante6. Ces clichés,
qu’il date de 1924, constituent, avec quelques dessins d’exécution du gros
œuvre, l’essentiel des sources pour ce projet. Ce sont ces mêmes photographies
qui seront ensuite publiées par l’architecte chez Charles Massin en 19307.
Elles
mettent paradoxalement en valeur, à travers l’image d’une des premières «ruines
modernes», les principes cubistes de la villa, dont l’état d’inachèvement
renforce l’aspect monolithique de la construction et l’écriture formelle de
l’architecte.
Ainsi
dématérialisé, le bâtiment se prête à une lecture essentiellement plastique des
volumes, dont les effets de masse et d’évidement suscitent la fascination du
commanditaire : «Tous mes matériaux avaient été portés à pied d’œuvre et
la maison était sortie du sol comme une plante vivace par les soins du
prestigieux architecte qu’est Mallet-Stevens. Elle était toute blanche, pure,
majestueuse, et un peu provocante, comme un lys […]. Où pouvais-je abriter ma
fuite, sinon dans ce coin clair et riant d’Île-de-France? La maison était inhabitable,
mais la maison du garde pouvait convenir à la modestie de mes besoins. Elle se
composait de deux chambres, d’une salle à manger, d’une cuisine, d’un garage et
d’une niche à chien. On pouvait se tailler un bonheur dans ce cube de ciment
armé8.»
Dans ses
écrits, Mallet-Stevens affirme que le béton armé est le matériau le plus à même
de mettre en œuvre «l’art essentiellement géométrique» qu’est pour lui
l’architecture9. Cependant, les images du chantier
de Mézy révèlent, sous l’apparence monolithique, une construction plus
traditionnelle10. En fait, un enduit épais recouvre
la maçonnerie de moellons et de briques et rend homogène l’aspect de la façade.
L’usage du béton armé est limité à certains linteaux et aux porte-à-faux qui
prolongent l’habitation sur les toits-terrasses. Plus qu’un propos sur la
construction, le discours de Mallet-Stevens met en relief le processus par
lequel un matériau «fait image». Tout semble se passer comme si l’architecte
construisait un imaginaire formel depuis les modes de production en béton armé
qu’il envisage, sans être effectivement en mesure de le concrétiser. Si le
château de Paul Poiret fait figure de prototype, c’est dans la mise en
application à grande échelle des principes architectoniques que, jusqu’alors,
Mallet-Stevens n’avait définis qu’au travers de ses travaux théoriques.
«Surfaces unies, arrêtes vives, courbes nettes, matières polies, angles droits
; clarté, ordre. C’est ma maison logique et géométrique de demain11.»
L’étagement et le déboîtement des volumes sont déjà familiers du vocabulaire de
l’architecte. Leur mise en œuvre révèle l’usage d’une trame rigoureuse, qui
détermine l’ordonnancement des percements, ainsi que le dessin du pavage du
patio. En outre, ce dernier laisse supposer l’existence d’un tracé régulateur,
qui unifie par la diagonale les trois ailes de la construction. C’est
certainement dans le grand hall que la structuration du cube à partir de ses
diagonales est la plus manifeste12.
L’édifice
inachevé resta à l’abandon pendant plusieurs années, avant d’être racheté vers
1933 par Elvire Popesco. L’artiste dramatique acquiert le château de Mézy par
l’intermédiaire du frère de Mallet-Stevens. C’est donc tout naturellement à ce
dernier qu’elle s’adresse pour achever la construction de la villa et en
conforter l’usage domestique. Les différents documents datés de 1938-1939,
portant le nom de la cliente en cartouche, montrent une étape ultérieure de
l’élaboration du projet avec l’apparition du second œuvre, notamment les
menuiseries. Les travaux envisagés ne pourront être menés à bien par
Mallet-Stevens, celui-ci s’étant réfugié avec son épouse dans le Sud-Ouest
après la déclaration des hostilités en 1939. C’est finalement un autre
architecte, Paul Boyer, qui achèvera les travaux après-guerre, en modifiant le
projet initial.
Aurélien
Lemonier


Château
de M. Paul Poiret, Mézy, 1921-1923.
Photo
Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris
PROPRIÉTÉ
DU VICOMTE DE NOAILLES, HYÈRES, 1923-1928
C’est au printemps
1923 que Charles et Marie-Laure de Noailles confient à Mallet-Stevens le projet
de cette petite maison dans le midi, modeste résidence d’hiver qui deviendra au
fil d’agrandissements successifs l’étrange château moderne, prétexte au film
surréaliste de Man Ray : Les Mystères du château du dé1.
Cette
année charnière, au cours de laquelle l’architecte étudie aussi le Château de
Mézy2 pour le couturier Paul Poiret, est
celle de ses premiers contacts avec des clients et des sites réels. Cinq ans
après la fin de la guerre, Mallet-Stevens, âgé de 37 ans, n’a encore réalisé
aucun de ses projets, se limitant à la publication d’articles, à la
construction de décors éphémères et de maquettes, à la participation à des
salons et expositions.
Charles
et Marie-Laure, aristocrates fortunés et mécènes en renom, avaient reçu en
cadeau de mariage un terrain dominant la vieille ville de Hyères, sur la côte
varoise ; collectionneurs très impliqués dans les mouvements artistiques de
leur époque, animés par l’envie de prendre une part active, comme clients, à
l’aventure de la modernité, ils se mettent en quête d’un architecte capable de
conduire pour eux l’expérience d’une maison moderne. Après avoir rencontré Mies
van der Rohe, au Bauhaus de Weimar, puis consulté Le Corbusier, considérés
comme représentant l’avant-garde, ils s’adressent à Mallet-Stevens, présenté
comme un homme de goût et d’imagination par un ami commun. «Nous nous sommes
bien entendus, il était de rapports agréables3.»
Enclos
dans la deuxième enceinte médiévale du casteou, le terrain, couvrant à
l’origine 1, 5 ha du versant sud de la colline du vieux château, est traversé
d’est en ouest par l’ancien chemin de l’abbaye Saint-Bernard. Des murs de
soutènement l’organisent en terrasses, autrefois vouées aux cultures
maraîchères. En amont du chemin, une vieille bâtisse, seul reste du couvent
qu’occupaient des bernardines, bloque le côté est de la plus vaste des
terrasses servant d’assiette à la nouvelle construction. Elle sera adaptée en
bâtiment des communs. Sous cette terrasse, le long du chemin, trois caves
voûtées pourront également être intégrées au projet.
Noailles
commande une «petite maison, intéressante à habiter», pour profiter du soleil.
À l’exposition qu’il organise en mars 1924 à l’École spéciale d’architecture,
Mallet-Stevens présente un avant-projet de «résidence d’hiver pour le vicomte
de Noailles4».
Le dessin
en perspective évoque les planches de l’album Une cité moderne, par le
graphisme comme par la volumétrie générale et la modénature des façades, encore
teintées d’art décoratif. Toutefois, le plan montre à l’évidence que le projet,
loin de n’être qu’une image donnée à voir, s’appuie sur les données physiques
du terrain : la construction intègre à l’ouest l’extrémité de l’édifice
ancien, prend appui au sud sur le mur existant au long de la route d’accès et
qui lui sert de soubassement. Le volume du corps central, contenant un grand
hall de réception sur deux niveaux, est magnifié par des meneaux de béton d’une
dizaine de mètres de haut qui l’ancrent jusqu’au sol de la route. La
composition est dominée par un volume vertical contenant l’escalier, culminant
en belvédère. Cet avant-projet ne semble pas convenir au client, si l’on se
réfère à leurs échanges. Le 25 juin 1923, Charles de Noailles adresse à
Mallet-Stevens un schéma de disposition intérieure montrant l’orientation des
chambres à l’est et du séjour à l’ouest. Le 5 juillet 1923, réagissant vivement
à une première esquisse de l’architecte, il lui écrit : «J’ai envie de
bâtir une maison extrêmement moderne, mais par moderne j’entends employer tous
les moyens modernes pour arriver au maximum de rendement et de commodité. Je ne
compte pas plus sacrifier un pouce de fenêtre pour obtenir une façade Louis
XVI, que pour obtenir une façade moderne intéressante.»
Cependant,
à la même exposition, Mallet-Stevens montre un «projet de villa, 1924».
S’agit-il d’un projet sans site, dans la poursuite de ses recherches, destiné à
cette fameuse exposition ? Le programme est modeste et les volumes sont
simples, sans commune mesure avec la commande des Noailles. Sa première
proposition repoussée, on peut penser que Mallet-Stevens va se servir de cette
étude pour en soumettre une nouvelle à ses clients, tant la similitude des
principes volumétriques rapprochent le bâtiment réalisé de cette «villa 1924»
et l’éloigne de la première version.
En effet,
le projet définitif de janvier 1924 montre une toute autre implantation.
L’édifice est plus en retrait sur la terrasse existante, son emprise est
limitée par l’allée longitudinale. La relation avec le bâtiment existant et
avec les salles voûtées est réduite à de simples galeries. L’organisation
intérieure, comme celle des façades, est plus sobre, plus systématique. Le hall
d’entrée et les espaces de séjour sont de dimensions modestes. La composition
pyramidale, axée sur la tour-belvédère, est plus affirmée. Le jeu des volumes
est étudié pour être découvert latéralement, d’est en ouest, depuis l’allée, à
la manière d’un chemin de travelling.
Charles
de Noailles et Mallet-Stevens conviennent de confier la conduite des travaux à
un architecte local, Léon David, qui s’était occupé du relevé de l’état des
lieux.
Architecte
expérimenté, auteur de nombreux édifices publics éclectiques et de villas
régionalistes, David apportera au fil du chantier une maîtrise technique qui
faisait défaut à Mallet-Stevens, sans toutefois l’encourager sur la voie de
l’innovation. Une entreprise de Marseille spécialisée dans la construction en
béton armé est consultée, sans succès. L’édifice sera réalisé en maçonnerie
traditionnelle par un artisan local. La première phase de chantier est
entreprise en avril 1924 et s’achève en décembre 1925. Des modifications
importantes surviennent en cours de chantier, comme la suppression du
belvédère, jugé trop décoratif, à la demande de Charles de Noailles :
«Mais si vous vous en souvenez, je vous ai dit dès le premier jour que je ne
pourrais jamais supporter quoi que ce soit dans la maison ayant un but
seulement architectural et que je cherchais une maison infiniment pratique et
simple, où chaque chose serait combinée du seul point de vue de l’utilité. Vous
voyez pourquoi, maintenant, chaque fois que je regarde la tour, qui donne
forcément à la maison un côté architectural, elle me représente tout ce que je
désirais éviter [...] Je me rends compte que je n’y remonterai plus jamais et
que son côté architectural m’ennuiera plus de jour en jour5.»
L’architecte ordonne à regret la démolition partielle du belvédère.
C’est
sans doute pour les mêmes raisons qu’est rejeté le projet d’une élégante
cheminée de jardin destinée à évacuer les fumées du foyer du grand salon
provençal situé au sous-sol. On préférera à cet objet sculptural haut de 9 m,
préfigurant la tour du Pavillon du tourisme de l’exposition de 1925, une
solution discrète et efficace : un simple conduit, dissimulé dans
l’épaisseur du mur.
Au
contraire, la réalisation d’un mur d’enceinte percé de baies, en surélévation
du parapet de la terrasse-parvis, est décidée d’un commun accord6. Cette
étonnante disposition, qui permet d’enclore une vaste pièce extérieure en
découpant le paysage en tableaux, semble suggérée par le client lui-même. Dans
le paysage, cet écran joue comme une réminiscence des ruines du vieux château
qui domine le site. Il entoure de mystère la nouvelle construction et dissimule
ses occupants.
Six mois
après l’ouverture du chantier, Noailles demande l’ajout de trois chambres au
projet. Connectée par un long couloir greffé à l’escalier central, l’aile de
«l’annexe» est un simple parallélépipède implanté au long de la galerie de
service conduisant au bâtiment des communs. Le couloir distribue les chambres
au nord, et le toit de la galerie est utilisé comme terrasse. Pour abriter
voitures et chauffeurs, un bâtiment distinct est dessiné par Léon David à l’ouest
des communs. Un traitement unitaire des façades et des toits-terrasses donne à
l’ensemble un aspect homogène, masquant les différences constructives et
historiques. Les constructions anciennes et nouvelles, les maçonneries
traditionnelles et les quelques voiles de béton armé sont unifiés par un même
épiderme.
La villa,
achevée en décembre 1925, est déjà très confortable, sans luxe ni ostentation,
mais loin de la modeste «petite maison» du programme initial. En plus des
nombreuses annexes et espaces de service, les appartements des Noailles et de
leurs invités comptent huit chambres de petite taille, et autant de salles de
bains ouvrant toutes au sud sur une terrasse extérieure. Une petite salle à
manger et un salon sont heureusement complétés par l’aménagement, dans les
salles voûtées, d’un grand hall et d’un salon de 70 m2 chacun.
Aucune
trace de décor ou d’ornement. Seule une horloge, dessinée par Francis Jourdain7,
répercute la même heure au mur de chaque pièce. Dans la même logique de
dépouillement que celle des volumes extérieurs, les espaces ne sont animés que
par le jeu de la lumière sur les matériaux simples qui en forment les
parois : sol en terrazzolith8, murs badigeonnés à la chaux. Même
les luminaires en appliques sont constitués d’une niche maçonnée.
Des
œuvres d’un artiste sont intégrées ici ou là : deux vitraux de Barillet
éclairant les paliers de l’escalier, un bas-relief des frères Martel sur la
colonne centrale, dans l’entrée, une porte associant cinq métaux, véritable
composition néoplastique de l’orfèvre dinandier Claudius Linossier9.
Le
mobilier utilitaire s’intègre souvent aux parois : placards et penderies
murales, mais aussi aménagements de la salle à manger. Pierre Chareau, à qui on
commande du mobilier, aménage une «chambre en plein air à l’américaine10» sur la
terrasse de la chambre de Monsieur. Les artistes hollandais du groupe De Stijl
apportent leur touche au projet. Theo Van Doesburg est convié dès 1924 à
réaliser la mise en couleur des parois d’une petite pièce consacrée à la
confection des bouquets11. Seybold Van Ravesteyn12 est
chargé du mobilier et de la polychromie de la chambre d’amis du deuxième étage,
qu’il réalise en janvier 1926. La composition avec gris et noir, l’une des deux
seules toiles de Mondrian vendues en France de son vivant, trouve place au mur
de cette chambre.
Après
leur séjour inaugural de janvier 1926, les Noailles décident de pousser plus
loin l’expérience architecturale et d’augmenter leur capacité d’accueil. Le
couloir de l’annexe s’étire vers le haut de la propriété. Une aile de quatre
chambres d’amis est construite, ouvrant sur un jardin suspendu. Djo Bourgeois13 en
conçoit l’aménagement intérieur. À l’arrière, c’est l’occasion d’ajouter sept
chambres de domestiques. Les formes et les matériaux sont les mêmes que ceux
des constructions précédentes. La même année, séduit par le «jardin d’eau et de
lumière» présenté à l’exposition de 1925 par Gabriel Guévrékian, Noailles lui
commande, par l’intermédiaire de Mallet-Stevens, le jardin triangulaire à l’est
de la villa14. Moins un jardin qu’une sculpture
géométrique rigoureuse, il alterne en damiers les dalles de mosaïque de pâte de
verre avec les jardinières de tulipes, en une figure qui finalement fusionne
avec les parois qui la limitent. Si, en maquette, il apparaissait comme un
enclos dont une fontaine constituait le point focal, en réalité, le sommet du
triangle s’ouvre largement sur le paysage. Lors du chantier, le vicomte fait en
effet disposer, sur un socle tournant à la pointe du jardin, une sculpture
commandée à Jacques Lipchitz et, interrompant le mur périphérique, ouvre une
brèche à l’extrémité du kaléidoscope.
Fin 1926,
Mallet-Stevens étudie pour la villa d’Hyères un «atelier» de 50 m2 qui vient
opportunément compléter les espaces de séjour, pour des invités plus nombreux15. Cette
nouvelle extension, qui occupe une cour fermée au nord du hall, prend la forme
d’une construction simple, carrée, couverte d’une verrière. La réponse de
l’architecte à cette implantation particulière, interdisant toute relation avec
le dehors, est recentrée sur l’architecture intérieure. Les parois, libres de
fenêtres, sont animées par un traitement en relief de la contre-cloison en
brique, dont les niches et décrochés répondent aux jeux de niveaux du plafond
suspendu, en une composition «intégrale» aux références néoplastiques. Le
vitrail monochrome de Louis Barillet16 diffuse, grâce aux quatre types de
verre «soleil» qui le composent, une lumière douce et régulière, efficace pour
un atelier et valorisante pour l’architecture intérieure et le relief des
parois. Dans cet «atelier», achevé pour l’hiver 1927, culmine l’esprit
fonctionnaliste du mobilier : table en tôle laquée grise montée sur
roulettes, lampes métalliques articulées, sièges en tube chromé et toile blanche,
fauteuils en caoutchouc.
Le
reportage photographique de Thérèse Bonney réalisé en février 1928 montre aussi
la piscine achevée. Il s’agit d’une autre surprise, contrastant, comme
l’atelier, avec le dépouillement des appartements. Un autre point fort de
l’expression formelle est offert par ce vaste volume au plafond lumineux,
s’ouvrant par de larges baies vitrées sur une grande terrasse, constituée du
toit de l’annexe. Répondant à une logique apparemment complexe, une poutraison
de béton armé disposée en diagonale décompose le plafond en figures
géométriques simples de béton mince, incorporant des ensembles de pavés de
verre, et produit l’effet saisissant d’un vitrail géant. Les grands châssis
vitrés s’escamotent dans le sol pour permettre une continuité parfaite avec la
terrasse extérieure, affectée à la culture physique. Le programme des espaces
voués au sport s’enrichit l’année suivante d’un gymnase, puis en 1932 d’une
salle de squash, qui viennent densifier la construction en occupant les espaces
laissés libres entre les volumes bâtis et les murs de soutènement des
terrasses. D’autres extensions, strictement quantitatives, sont réalisées
entre-temps, dont une aile de chambres, dite «pavillon», affectée au logement
des domestiques, à l’extrémité ouest, et diverses modifications densifiant la
zone des communs.
À l’issue
des différentes campagnes de travaux, qui alternent avec les séjours des
Noailles, la villa compte une soixantaine de pièces principales sur plus de
2000 m2, constituant dans le site un ensemble globalement homogène. Cependant,
la moitié de ces espaces affectés au service et au logement des domestiques
semblent avoir été conçus principalement par l’architecte local, Léon David.
Les matériaux de revêtement comme le traitement architectural les différencient
des espaces de maîtres. Contrastant avec la modernité réservée à ces derniers,
l’aménagement intérieur des espaces de service s’accommode de tomettes
provençales, des produits les plus courants pour les huisseries, la quincaillerie,
l’appareillage électrique ou sanitaire. Par-delà les différences de confort,
une médiocrité architecturale se trahit en façade par des ouvertures aux
proportions quelconques ; des volets à persiennes apparaissent ici ou là.
Du
résultat composite de ces adaptations et extensions successives, laissant place
à l’improvisation, provient sans doute la relative discrétion dont fit preuve
la presse spécialisée et professionnelle. Seul le magazine Art et décoration
consacre en juillet 1928 un article complet, illustré des photos de Thérèse
Bonney. La réussite de l’opération n’apparaissait avec évidence qu’à ceux qui
avaient le privilège d’y séjourner : «La maison réservait une surprise
après l’autre, et inépuisables paraissaient ses ressources17». Man
Ray, invité par Charles de Noailles à réaliser un film de fiction, est
enthousiasmé par le décor naturel. Dans Les Mystères du château du dé18, une
fantaisie surréaliste prenant pour argument les premiers vers d’un poème de
Mallarmé, «Un coup de dé jamais n’abolira le hasard», Man Ray met en scène les
amis de son commanditaire, mais s’amuse surtout à lancer la caméra en une
découverte exhaustive des qualités architecturales de la villa Noailles.
Progressivement,
les Noailles se détachent de l’architecture. Après une période d’abandon et de
dégradations, dues à la guerre, Marie-Laure occupe seule, l’été, une partie de
la villa, où elle procède à des réparations malheureuses et à des modifications
discutables. Après son décès, la villa est rachetée en 1973 par la municipalité
d’Hyères, protégée au titre des Monuments historiques en 1975, et bénéficie à
partir de 1986 de campagnes de restauration19.
Jacques
Repiquet et Cécile Briolle



Propriété
du Vicomte de Noailles, Hyères, 1923-1928.
Photo
Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris
HÔTEL
PARTICULIER DE MME COLLINET, BOULOGNE-BILLANCOURT, 1925-1926
Cet hôtel
particulier se situe à proximité du bois de Boulogne, 8 rue Denfert-Rochereau,
dans une voie nouvelle. Il se situe sur une parcelle large de dix mètres, la
propriétaire constituant, à partir du terrain d’origine, deux autres lots. Deux
autres villas de proportions identiques seront ainsi bâties entre 1926 et 1927
par Le Corbusier et Raymond Fischer. Elles forment un ensemble remarquable et
particulièrement homogène, chacun des architectes tenant compte de l’œuvre
antérieure. Les contraintes d’urbanisme sont drastiques ; la volumétrie de la
Villa Cook de Le Corbusier prendra en considération les proportions de celle de
Mallet-Stevens qui la précède et lui est mitoyenne.
Élevée
sur une parcelle étroite et assez profonde, la Maison Collinet est construite
dans l’alignement. Un jardinet la sépare de la rue ; le vrai jardin se trouve
derrière.
Le
programme est assez simple : deux chambres de maîtres, au deuxième, un vaste
volume de réception au premier comprenant un hall-salon-atelier d’artiste
ouvrant sur l’arrière, une bibliothèque côté bois, et une salle à manger – que
dessert un simple office avec évier et monte-plats – constituent l’assiette de
ce programme1. Grâce à l’emploi du béton armé et
au plan libre qui en résulte, Mallet-Stevens crée un espace totalement ouvert
sur le hall-salon. Une simple marche sépare visuellement celui-ci de la salle à
manger. Les services et le garage sont au rez-de-chaussée. L’escalier, saillant
sur la façade, est éclairé par une longue fenêtre verticale qui contraste avec
l’horizontalité des autres fenêtres. Sa disposition demeure traditionnelle. En
comparaison avec son illustre voisine, la Maison Collinet demeure encore
conventionnelle malgré ses pièces de réception aux volumes modulés, sa
mezzanine et ses chambres aux proportions confortables. Toutefois, nous sommes
bien loin des inventions plastiques et surtout structurelles de la villa Cook,
dans laquelle Le Corbusier applique pour la première fois toutes les
composantes de ses «cinq points». Rappelons ici, l’emploi des pilotis qui
permettaient de dégager le rez-de-chaussée et d’une «nacelle» type avion qui
englobe l’entrée et le départ de l’escalier, les cloisons et le mur de façade
incurvés et surtout la révolutionnaire inversion du plan qui la caractérise.
Les
chambres de maîtres et de domestique sont placées au premier. Le salon-atelier
qu’une cheminée non-conformistes sépare symboliquement de la salle à manger et
la cuisine montent au second étage. La mezzanine de l’atelier, en soupente,
s’ouvre sur une terrasse aménagée avec auvents et points de vues renouvelés sur
le bois.
Si le
balcon plein en béton de «la chambre de madame» et l’auvent apportent une
touche moderne à la façade sur rue de la Maison Collinet, les fenêtres, certes
en longueur, sont dans l’épaisseur du mur. Celles de la Villa Cook sont en
bande continue et affleurent sur la façade... preuve de l’appartenance de
celle-ci au Style international2.
La façade
arrière de la Maison Collinet est caractérisée par le balcon régnant à l’étage
de réception, et par la haute verrière qui éclaire la salon-atelier. Les
élévations et l’organisation même du plan renforcent cette opposition entre
avant et arrière. En fait, cette villa s’apparente assez à la production
contemporaine d’Adolf Loos. Ses fenêtres, par exemple, présentent des analogies
avec la «typologie» des huisseries que Loos3 emploiera pour la Maison de Tristan
Tzara (1927). Il faut surtout voir dans la Maison Collinet le prélude à la
villa urbaine ou villa-atelier qui caractérisera la rue Mallet-Stevens.
Olivier
Cinqualbre

Hôtel
particulier de Mme Collinet, Boulogne-Billancourt, 1925-1926.
Photo
Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris
RUE
MALLET-STEVENS, PARIS, 1926-1934
Souvent
comparée dans la presse de l’époque à la Cité Seurat, qui compte des villas
modernes signées Perret et Lurçat, la voie nouvelle que Mallet-Stevens crée et
bâtit dans le XVIe arrondissement repose sur une opération immobilière
originale. À son origine se trouvent Daniel Dreyfus, propriétaire d’un terrain
situé derrière son domicile du 71 rue de l’Assomption et susceptible d’être
loti, Mallet-Stevens, qui a déjà eu ce dernier pour commanditaire lors de la
rénovation de l’hôtel des Roches noires, à Trouville, ainsi que des clients
potentiels appartenant à leurs cercles de relations.
Le
terrain occupe une surface totale de 3 827 m2. Le projet de lotissement est
approuvé en préfecture le 12 septembre 1925. À partir de ce moment, achats de
terrains et dépôts de permis de construire vont s’échelonner jusque dans le
courant de 1926. Un syndicat de copropriétaires est constitué, dont le rôle
«d’aménageur» de la voie est effectif dès novembre 19261. Trois
premiers bâtiments, destinés à Mme Reifenberg, à M. et Mme Allatini, et à M.
Dreyfus, sont édifiés ensemble, suivis de ceux des familles Martel et
Mallet-Stevens.
En mai
1926, alors que les chantiers sont lancés, l’architecte livre un texte
concernant son projet : «La rue que j’ai la bonne fortune de construire
est située à Auteuil et aboutit rue du Docteur-Blanche. Aucun commerce n’y est
autorisé. Elle est exclusivement réservée à l’habitation, au repos ; on doit y
trouver un calme réel, loin du mouvement et du bruit, et son aspect même, par
sa structure générale, doit évoquer la placidité sans tristesse. Une rue peut
être gaie, joyeuse, même, tout en étant “reposante”. Elle ne doit pas forcément
emprunter ses lignes à celles d’un cimetière pour engendrer l’idée de repos ;
d’ailleurs, le Campo Santo de Gênes, par son architecture compliquée,
tourmentée, n’est pas “reposant”. La chaussée, pavée en éventails de grès, sera
bordée de trottoirs agrandis par de larges bandes de gazon formant zone non
aedificandi. Aucune barrière ne limitera ces zones, la verdure allant
directement du trottoir aux maisons. L’aspect général sera donc de maisons
parmi des jardins, d’hôtels particuliers au milieu d’un seul jardin. Ces hôtels,
ayant chacun un programme spécial, sont très différents les uns des autres,
mais conçus dans un même esprit afin de créer une unité. Si les programmes ne
sont pas semblables, les exigences de chacun des habitants sont les
mêmes : de l’air, de la lumière. Aussi toutes les baies sont vastes, très
vastes, corrigées en tant que température par le chauffage central. Les
constructions sont en béton armé, autorisant de grandes portées sans points
d’appui intermédiaires, permettant des espaces libres sans poteaux. Toutes ces
maisons sont couvertes en terrasse. […] La maison du “repos” doit et peut avoir
un coin fleuri, un espace à ciel ouvert. Et toutes ces terrasses à différents
étages, disposées en gradins, sur une rue entière, procureront un ensemble de
verdure s’harmonisant avec les lignes calmes de l’architecture2.»
Bien que
les chantiers intérieurs des deux derniers hôtels ne soient pas achevés, la rue
est inaugurée le 20 juillet 1927, en présence de M. Bokanowski, ministre du
Commerce et de l’Industrie, de MM. Bouju, préfet de la Seine, et Chiappe,
préfet de police, de Paul Léon, directeur des Beaux-Arts, et de Fernand
Laurent, conseiller municipal d’Auteuil. «Cette manifestation d’art
architectural moderne» est filmée par les actualités cinématographiques des
firmes Gaumont et Pathé et abondamment couverte par la presse généraliste3.
Si le
traitement de la zone non aedificandi est conforme au propos de Mallet-Stevens,
la réalité paysagère est en deçà des prétentions affichées. Mme Reifenberg aura
beau faire planter un cèdre bleu, la rue Mallet-Stevens n’en demeure pas moins
très éloignée d’une cité-jardin. Son aspect minéral, ses proportions, son unité
architecturale la projettent dans une dimension urbaine affirmée. Son
équipement même en fait une rue moderne : «L’éclairage sera assuré par
trois candélabres en béton armé dessinés par M. Mallet-Stevens, d’un modèle
analogue à ceux de l’exposition… Paris 1925, avec luminaire identique à celui
de la rue La-Fontaine, Paris XVIe4». «Tous ces hôtels ont été érigés en
béton» : c’est ce que proclame l’architecte et que relèvent les
journalistes. Pour l’un, il y a là l’affirmation de la modernité, pour les
autres l’explicitation de cette esthétique nouvelle. La réalité constructive
est plus nuancée, comme l’expose Mallet-Stevens : «Leur structure est
nettement apparente. La pierre n’intervient jamais pour la masquer. Mais seule
l’armature, c’est-à-dire le cadre fixe, est en ciment armé. Les parois qui ne
supportent rien sont en brique creuse, isolant d’une parfaite étanchéité. Je
compare volontiers ce mode de construction à celui d’une ombrelle, dont le
cadre est en fibres métalliques, qui maintiennent la soie. Les murs mitoyens
sont en pierre, ainsi que l’exige la municipalité5.» Pour
unifier structure et remplissage, se pose alors la question du
revêtement : un crépi est choisi, par souci d’économie, mais sans doute
aussi pour l’image, recherchée, de construction en ciment armé. Les surfaces
sont nues et lisses, à l’exception des soubassements : un relief en cannelures
horizontales file au bas de toutes les façades et les murs de la rue. Le
chantier de gros œuvre est assuré dans sa totalité par l’entreprise de
maçonnerie dirigée par André Lafond, et son suivi assumé principalement par
Gabriel Guévrékian6. Au fil des entretiens qu’il
accorde, Mallet-Stevens revendique l’emploi du béton pour les grandes
dimensions des ouvertures et des porte-à-faux, qu’autorise ce matériau. Il
souligne constamment l’importance donnée aux éléments de second œuvre (fenêtres
à glissière, canalisations encastrées, sols sans joints…), à l’équipement
moderne (chauffage central, téléphone inter-communication dans chaque pièce,
sirènes d’alarme anti-effraction…). Enfin, il insiste sur la cohérence
architecturale de l’opération : «Renonçant à un individualisme souvent
préjudiciable à l’harmonie générale, mes clients ont accepté que leurs hôtels
respectifs, tout en gardant leurs caractéristiques, fissent partie d’un
ensemble, c’est-à-dire d’un corps d’architecture un et indivisible. Ces hôtels
ne sont pas juxtaposés au petit bonheur ou suivant les hasards d’une
construction livrée à l’anarchie. Une idée commune a régi leurs rapports. Aussi
forment-ils un bloc parfaitement homogène7.»
C’est
précisément cette dimension d’ensemble qui donne toute sa portée à la rue
Mallet-Stevens. Si les photographies des bâtiments sont fréquemment reproduites
dans la presse française et étrangère, si les commentaires des journalistes –
séduits, dubitatifs ou défavorables – abondent, si la rue provoque même des
réactions d’écrivains8, l’analyse architecturale est rare
et peu prolixe. Howard Robertson et Frank Yerbury font de la rue le sujet d’un
de leurs voyages en architecture moderne ; Siegfried Giedion et Theo Van
Doesburg, chacun dans sa visée théorique, s’emparent de cette réalisation pour
reprocher à Mallet-Stevens, l’un son formalisme, l’autre son manque de rigueur
théorique9.
Quant au
nom attribué à cette voie, l’explication est donnée par l’architecte : «Ce
sont les habitants de cette rue qui ont demandé eux-mêmes à M. Qui-de-Droit
l’autorisation de lui donner mon nom10.»
Olivier
Cinqualbre

Inauguration
de la rue Mallet-Stevens, 1927.
Photo
D.R. / Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens
/ © ADAGP, 2004, Paris

Rue
Mallet-Stevens vue depuis son extrémité, 1927.
Photographie
Marc Vaux, tirage original 17,4 x 23,3 cm / Centre Pompidou, Mnam-Cci,
Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens, don de M.J. Videlier Martel / © ADAGP,
2004, Paris
HÔTEL
PARTICULIER DE MME REIFENBERG, RUE MALLET-STEVENS, PARIS, 1925-1927
L’hôtel
particulier pour Mme Reifenberg est le premier projet qui voit le jour dans la
future rue Mallet-Stevens. Il porte le numéro 4-6. Le terrain est acquis le 9
octobre 1925. Déposé quelques jours après – le 19 octobre –, le permis de
construire est refusé le 27 du même mois, puis accordé le 27 juillet 19261. C’est
également l’édifice le plus imposant. La surface construite de la parcelle
mesure plus de 300 m2 et le bâtiment s’élève sur 4 niveaux, sans compter le
sous-sol et une terrasse qui s’étend sur la totalité de la toiture. L’échelle à
laquelle est confronté l’architecte est tout autre que pour ses précédentes
expériences urbaines, la maison Collinet ou la maison Auger. Ici, le bâtiment a
11, 45 m de profondeur, pour une façade de 27, 90 m. À l’arrière, une courette
offre des ouvertures possibles aux pièces en étage, mais la forme générale sous
laquelle on perçoit l’hôtel est un parallélépipède, avec, ici et là, des
retraits pour intégrer décrochements et terrasses. Suivant la méthode qu’il a
pu développer dans ses projets antérieurs, Mallet-Stevens privilégie
l’organisation intérieure et en fait dépendre la silhouette de sa construction.
L’élément structurant de la composition est la cage d’escalier. Celle-ci est exhibée
en façade, mais décentrée. Elle est ornée d’un vitrail de Barillet et Le
Chevallier sur toute sa hauteur, mais échancrée à son sommet, afin de ne
présenter que le volume nécessaire à sa fonction d’accès supérieur.
La
couverture des terrasses par des voiles de béton offre à l’édifice, avec les
arêtes des balcons, son lot d’horizontales ; en verticale, ce sont les
cheminées qui sont traitées en lames et scandent un des pignons. Ce jeu des
volumes et des lignes orthogonales, qui donnent à l’édifice sa dynamique, est
l’apanage de Mallet-Stevens. Un style personnel qui est décrié par Sigfried
Giedion : «L’architecte n’est pas venu au bout de la massivité congénitale
de cette maison d’habitation. Ses différents corps de bâti (cage d’escalier,
dalle de protection du toit, cube d’habitation) se juxtaposent sans
s’interpénétrer. On sent que les attributs du Nouveau Construire (surfaces
lisses, toit plat, absence de corniches, éléments en porte-à-faux) se
fragmentent en détails formels, alors que la conception d’ensemble est fondée
sur un type de construction qui sacrifie encore à une esthétique de la
représentation2.» Cette critique advient alors même
que Giedion reconnaît aux maisons de la rue Mallet-Stevens la capacité d’apporter
«la preuve de l’incompatibilité de l’architecture moderne et d’un style de
riches3».
À
l’exception du rez-de-chaussée, abandonné aux pièces techniques (garage,
lingerie, cuisine, resserre à malles) et aux chambres des domestiques, la
distribution est classique, réservant au premier étage les pièces de réception
et la chambre de la maîtresse de maison, et aux deux autres étages les chambres
d’enfants et d’amis. Pour décorer et meubler l’ensemble de ces pièces, il sera
fait appel à des créateurs modernes proches de l’architecte : Pierre
Chareau, Francis Jourdain, Gabriel Guévrékian, Bernard Bijvoet, Noémi Hess. La
décoration intérieure signée Mallet-Stevens se limite donc à l’entrée et à la
cage de l’escalier : «Chez Mme Reifenberg, une large porte vitrée, sous un
auvent, donne accès au vestibule… pas tout à fait : il faut encore
franchir une grille solide de M. Jean Prouvé, une très belle grille, et très
originale dans sa simplicité. Pourquoi ce luxe de moyens défensifs ?
Prudence ou fantaisie ? Je pencherai plutôt pour la fantaisie – le
rigorisme de nos modernes architectes a de ces concessions –, une fantaisie
sans futilité, d’ailleurs. Il s’agissait de rompre l’uniformité d’une salle
carrée dont la destination ne comporte que peu d’éléments à tourner en décor.
On est bien obligé d’en venir à un peu d’arbitraire. Seulement, pour ne pas
trop le laisser voir, on reste dans l’austérité. Plus de boiseries sur les murs
et au plafond, c’est entendu ; des revêtements unis ; pas de meubles
inutiles : une seule banquette ; pas de tapis malsain : un sol
sans joints en cerazolite ; mais aussi une grille massive en fer. Et vous
allez retrouver partout du métal, du métal tout nu, comme pour un organe de
machine. Ses angles géométriques ont remplacé les arabesques, les fleurons et
les astragales. Au maniérisme a succédé le machinisme. On ne change pas
d’atmosphère en passant de l’usine à son home4.» Entre
un commentateur dont on ne sait s’il adhère au concept qu’il énonce et qui
renvoie implicitement à la formule de Le Corbusier selon laquelle la maison est
une «machine à habiter», et un critique sans grande retenue, proche du même Le
Corbusier, on mesure combien la voie de Mallet-Stevens fut, sous les jugements,
étroite.
Olivier
Cinqualbre
HÔTEL PARTICULIER
DE JOËL ET JAN MARTEL, RUE MALLET-STEVENS, PARIS, 1926-1927
L’atelier
des frères Martel, au n°10 de la rue, se distingue des constructions voisines,
tant par la taille de la parcelle (18.60 x 12 m) et par son programme que par
son organisation formelle. Un premier permis de construire est déposé le 20 mai
19261. Le refus de la municipalité
n’empêchera pas les travaux de fondation de commencer au début du mois de juin2, alors
que le gros œuvre de l’hôtel Reifenberg est presque achevé.
Outre la
spécificité du programme – un atelier pour les deux sculpteurs et trois
appartements autonomes –, la singularité de la demande permet à Mallet-Stevens
de mettre en œuvre une distribution intérieure rompant avec l’idée d’un espace
servant qui distribue les pièces de représentation. Comme le remarque Christan
Bonnefoi3, à la notion d’étage se substitue
celle d’articulation de volumes fragmentés, correspondant aux différents
éléments du programme, qui s’interpénètrent. En coupe, cette discontinuité est
clairement lisible. Elle est en effet issue de la dénivellation du
rez-de-chaussée, divisé en trois niveaux : l’atelier supérieur, au niveau
de la rue, l’atelier inférieur en contrebas de celle-ci (-1, 35 m), et la
loggia, en mezzanine sur l’atelier inférieur (+0, 90 m). Ce décalage se
répercute sur tous les niveaux de la construction et induit le positionnement
des étages supérieurs les uns par rapport aux autres.
Au centre
de la construction, le pivot central de la cage d’escalier, cylindrique,
recompose l’unité de l’ensemble. Il articule en effet les différents volumes
des appartements. De l’extérieur, l’émergence de son couronnement – un disque
en ciment dont la sous-face est carrelée en mosaïque rouge –, et le long
vitrail de Barillet courant sur toute la hauteur de la tour distinguent
celle-ci du reste de la construction. À l’intérieur, à la spirale continue de
l’escalier enfermée dans le cylindre4 répondent plusieurs volées de
quelques marches, accrochées au dos du mur de la cage, qui permettent de relier
les deux demi-niveaux d’un même étage. Cette dénivellation est désignée, depuis
la rue, par l’escalier droit situé à l’angle de la terrasse du premier étage,
qui, empiétant sur le volume de l’atelier de sculpture, dessert la terrasse
commune aux appartements du premier et du second5. C’est ce
dispositif complexe qui unifie la composition architecturale, faite de
l’imbrication de volumes géométriques simples – un cylindre, des cubes, une
oblique – et qui construit un espace fluide.
Le
bâtiment présente au visiteur trois entrées : à gauche le garage, à droite
l’atelier, au centre l’entrée principale – une porte réalisée par Jean Prouvé6. Ses
quatre panneaux de verre verticaux sont protégés par de longues bandes de métal
de 5 cm de largeur, disposées verticalement en lignes brisées alternées. Les
deux ouvrants centraux, légèrement en retrait, glissent latéralement pour
laisser entrer le visiteur dans le hall. C’est depuis ce hall que se fait la
séparation entre les circulations privées et celle réservée aux personnes
extérieures. En effet, soit on emprunte l’escalier contenu dans le volume
cylindrique central et on accède successivement aux trois appartements
autonomes des étages supérieurs ; soit on se dirige à droite, vers
l’atelier de sculpture de plain-pied ; soit, enfin, face à la porte
d’entrée, on emprunte un escalier accolé à la cage, afin de gagner l’atelier
inférieur. À mi-parcours, une dernière volée permet de gagner la
galerie-bibliothèque située en mezzanine et éclairée par une large verrière.
Cet espace devait être utilisé par les frères Martel pour recevoir leurs
clients.
En
contrebas se trouve l’atelier inférieur, destiné au moulage et au travail de la
glaise7. Sous la galerie, la partie gauche
de celui-ci est aménagée en pièce de repos et peut être isolée par un grand
rideau en toile caoutchoutée bleue monté sur rail.
Dans les
étages domestiques, c’est l’aménagement intérieur qui retient l’attention des
commentateurs de l’époque. Les frères Martel se sont fortement impliqués dans
le projet, tant financièrement8 que dans la conception de certains
aménagements : «L‘appartement du second étage a exactement la même
disposition que celui du premier, la terrasse en plus. De cette terrasse
recouverte de carrelage gris, rouge blanc et noir, nous pouvons passer par une
porte vitrée dans le living room. Les meubles ont été dessinés par Francis
Jourdain. Ils ont ceci de particulier qu’aucun d’eux ne touche le sol… Ce sont
des meubles coulissants. En effet, ils sont fixés au mur par deux tringles
parallèles et peuvent être déplacés le long de ces tringles suivant les
besoins. Ce sont des casiers, étagères, bibliothèques. Ainsi, le sol en granito
beige peut être nettoyé facilement…» Dans les chambres, nous retrouvons la même
attention portée au détail, ainsi que le principe d’un ameublement ancré dans
le mur et libérant ainsi le sol de tout obstacle visuel9. Citons,
en particulier, une penderie à porte coulissante et, dans la chambre voisine,
un studio-bar dessiné par Charlotte Perriand. Le troisième étage reprend également
les mêmes principes d’organisation que les deux précédents : deux chambres
(cette fois, pour les domestiques) et la cuisine ; quelques marches plus
haut, une grande chambre à coucher-studio, dessinée par Gabriel Guévrékian, se
prolonge vers l’extérieur par un court balcon. Et au dernier étage, la terrasse
supérieure, dont le sol est structuré par un motif géométrique polychrome, est
utilisé par les habitants comme solarium. De là, il est possible de gagner le
sommet de «l’observatoire» depuis lequel la vue, resserrée par le disque qui le
coiffe, cadre le regard sur les édifices de la rue.
L’atelier
des frères Martel n’a pas été modifié depuis sa construction et présente encore
aujourd’hui son architecture d’origine.
Aurélien
Lemonier

Hôtel
Martel, vue de l’atelier.
Photographie
Marc Vaux, tirage original 18 x 23,5 cm / Centre Pompidou, Mnam-Cci,
Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens, don de M.J. Videlier Martel / © ADAGP,
2004, Paris


Hôtel
particulier de Jan et Joël Martel, rue Mallet-Stevens, Paris, 1926-1927.
Photo
Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris
HÔTEL
PARTICULIER DE M. ET MME MALLET-STEVENS, RUE MALLET-STEVENS, PARIS, 1926-1927
Le 5 août
1926, une demande de permis de construire pour un hôtel privé est déposée par
Mme Mallet-Stevens, résidant 236 rue du faubourg Saint-Honoré, à Paris1. L’accord
est donné cinq jours plus tard. Ce bâtiment de quatre étages est destiné à
l’agence de l’architecte et à l’habitation de sa famille. Dans la voie
constitutive du lotissement, il se situe au n°12 et occupe une place
particulière, à l’un des angles avec la rue du Docteur-Blanche. L’entrée de
l’agence et le garage donnent sur la rue Mallet-Stevens, celle du domicile rue
du Docteur-Blanche. La totalité de la parcelle est bâtie au rez-de-chaussée.
L’agence occupe la moitié de la surface, l’atelier donnant, derrière une large
baie vitrée, sur la voie privée, et bénéficiant ainsi de son calme. Entre
l’espace de travail et l’espace domestique sont implantés le garage et une loge
de gardien. En étages, le corps principal est adossé au mitoyen arrière. Des
terrasses en décroché prolongent, ici et là, les chambres, mais la terrasse
principale, associée à un patio, occupe l’angle du bâtiment, au premier étage.
Elle est commandée par le vaste hall, dont le volume cubique, d’une double
hauteur, vient en retour, formant ainsi un L. Comme d’habitude dans l’approche
de Mallet-Stevens, ce sont les espaces intérieurs qui déterminent la volumétrie
et le dessin des façades. Les circulations verticales (l’escalier principal) et
horizontales (les galeries en étages) sont rejetées à l’arrière et distribuent
l’ensemble des pièces, alignées dans une même travée. Au premier étage, la
cuisine hérite d’une place inhabituelle, en façade sur la rue principale ;
la fluidité du hall et des espaces de représentation (la galerie, la salle à
manger, le salon) masque la trame constructive. Le deuxième est l’étage de la
demoiselle ; le troisième, plus vaste parce que couvrant le hall, est
dédié à l’appartement de Monsieur et Madame ; le dernier est celui des
domestiques. Comme avec ses clients, Mallet-Stevens fait appel à des créateurs
amis pour l’ameublement de certaines de ses pièces, se réservant l’aménagement
des espaces de réception et de son agence. La prépondérance donnée à
l’intérieur sur l’extérieur fait apparaître quelques failles dans la
composition. Ainsi, autant les proportions du hall sont élégantes, vues de
l’intérieur, autant la surface de ses hautes baies écrase la verrière, d’un
seul tenant, de l’agence. De même, si la terrasse en forme de proue, avec sa
partie protégée mais éclairée par un puits à ciel ouvert, est des plus
agréables lorsqu’on s’y trouve, en façade, son dessin laisse entrevoir des
maladresses : un linteau en ciment armé a beau reprendre en hauteur la
courbe de son pourtour, son accroche, d’un côté à une excroissance de la
cuisine, de l’autre au muret d’une terrasse, manque de maîtrise. Comme si
l’architecte, après avoir nié le traitement de l’angle de son bâtiment, s’y
essayait, mais seulement dans le registre de l’accessoire. À cette remarque
près, on peut dire que l’hôtel signale avec élégance la rue
Mallet-Stevens : légèrement en débord au-dessus de la porte d’entrée, un
volume alternant les vides des espaces vitrés et les pleins des allèges
maçonnées signale ce nouvel ensemble depuis la rue du Docteur-Blanche.
Après-guerre, l’édifice sera surélevé et les baies vitrées du hall dépouillées
des vitraux de Barillet, Le Chevallier et Hanssen.
Olivier
Cinqualbre

Hôtel
Mallet-Stevens, 1927.
Photographie
Marc Vaux, tirage original 22,7 x 16,1 cm / Centre Pompidou, Mnam-Cci,
Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens, don de M.J. Videlier Martel / © ADAGP,
2004, Paris

Hôtel
particulier de M. et Mme Mallet-Stevens, rue Mallet-Stevens, Paris, 1926-1927.
Photo
Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris
RUE
MÉCHAIN, IMMEUBLE DE RAPPORT, PARIS, 1928-1929
Rue
Méchain, rien ne signale l’existence d’une construction de Mallet-Stevens, si
ce n’est, pour l’œil averti, en rez-de-chaussée d’un immeuble traditionnel, des
vitraux de Barillet, Le Chevallier et Hanssen occupant deux oculus de part et
d’autre de la porte d’entrée de l’immeuble, signée Jean Prouvé. C’est en
passant par cet immeuble, dont l’architecte n’a fait qu’habiller les parties
communes, que l’on accède, dans une cour plantée, à la réalisation de
Mallet-Stevens. Il s’agit d’une maison de rapport édifiée à la demande de Jean Deschamps,
le propriétaire. Une première demande de permis de construire, déposée le 14
janvier 1928, a essuyé un refus pour défaut de conformité et manque d’éléments1 (un
dépassement de gabarit, et l’absence d’ouvertures pour les pièces d’eau). La
seconde aboutit, et la construction est achevée l’année suivante. La maison de
rapport est en fait un immeuble locatif de 14 appartements. Deux sont en
duplex, dont un atelier. Mallet-Stevens implante son bâtiment en fond de
parcelle et lui donne une forme de «L» afin d’orienter l’une de ses façades au
nord et la seconde à l’est. Les deux ailes sont inégales : en proportion
de sa hauteur, celle du fond occupe une petite largeur, sur six niveaux ;
l’autre s’étend sur la profondeur du terrain et compte neuf niveaux. Au sommet
de chacune d’elles, les étages sont en retrait ou n’occupent qu’une surface
réduite, ce qui atténue l’aspect massif de l’édifice. Entrée et cage d’escalier
sont situées à l’articulation des deux ailes. Elles sont logées dans un immense
monolithe incrusté dans l’angle du bâtiment et fendu sur toute sa hauteur par
un vitrail qui en amplifie la verticalité. Cette «tour» est autant le pivot
central de l’immeuble que l’élément majeur de la composition. Avec les
toitures-terrasses, les fenêtres d’angle et les grandes baies horizontales, le
jeu des volumes et le rapport des pleins et des vides, Mallet-Stevens déploie
l’ensemble de son répertoire formel. Par l’intervention de ses collaborateurs
(Salomon, Prouvé, Barillet et associés), il recrée tous les attributs de la rue
Mallet-Stevens. Mais l’atmosphère est autre : il ne s’agit plus de maisons
particulières mais de logements collectifs, plus d’édifices autonomes et
unitaires mais d’un bloc de taille imposante. Le rapport au client est aussi
très différent. Il convient avant tout pour le maître d’œuvre de se montrer
réaliste et performant vis-à-vis d’un commanditaire. On peut, à cet égard,
noter qu’un des rares articles qui lui soit consacré ignore l’architecture de
cette réalisation mais évoque ses caractéristiques constructives et de second
œuvre – ossature en béton armée et remplissage en briques creuses, portes et
menuiseries de l’escalier en acajou, rampe en émaux de Briare – et insiste en
particulier sur ses prestations techniques : deux ascenseurs, dont un de
service, des salles de bains pourvues de baignoires encastrables, des murs
garnis de faïences pour les pièces d’eau, le vidage des ordures par
incinération, les fenêtres à coulisses, les terrasses aménagées en jardins, le
chauffage central et l’alimentation en eau chaude2.
Olivier
Cinqualbre

Immeuble
de rapport, rue Méchain, Paris, 1928-1929.
Photo
Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris
PROPRIÉTÉ
DE M.CAVROIS, CROIX, 1929-1932

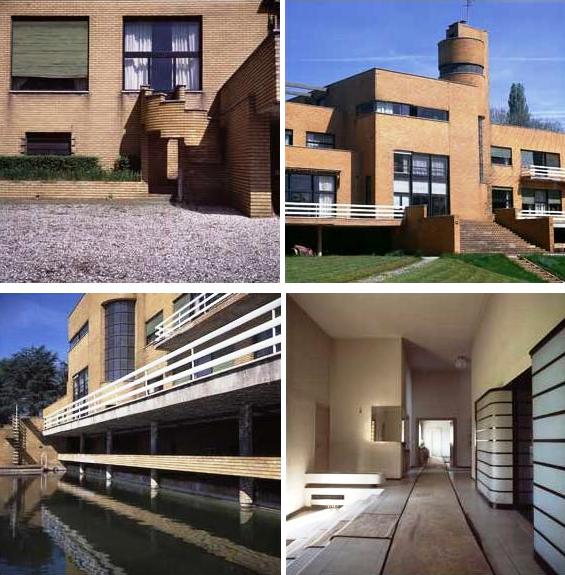

Propriété
de M. Cavrois, Croix, 1929-1932.
Photographies
Véra Cardot et Pierre Joly, 1986 / Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque
Kandinsky, fonds Cardot-Joly / © ADAGP, 2004, Paris
VILLA
CAVROIS, LA CHAMBRE DES PARENTS
À
l’étage, l’appartement des parents est un chef-d’œuvre de l’esprit UAM.La
chambre, traitée en monochromie – murs beige très clair, sol revêtu d’un tapis
en laine naturelle blanche, rideaux et dessus de lit en satin beige – dégage
une impression de luxueuse élégance. Les meubles et les boiseries ont été
réalisés en palmier naturel verni – une essence de bois de placage qui connaît
dans les années trente une vogue éphémère, illustrée par les meubles d’Eugène
Printz. De longues enfilades occupent, en partie médiane, deux des murs de
cette vaste pièce. La plus grande, qui mesure deux mètres quarante, est pourvue
de portes en palmier, munies de poignées cylindriques sur plaques
rectangulaires en cuivre patiné noir, et d’un encadrement ivoire (dessus, côtés
et base). Une table à double plateau, dotée d’un casier à secret, est placée
devant le lit. Les fauteuils sont en palmier, à dossier et assise rembourrés,
initialement recouverts de satin blanc. Les pieds et les accoudoirs ont une
section rectangulaire ; leurs traverses latérales et leurs sabots, comme ceux
de la table, sont en métal teinté «canon de fusil». Face à la fenêtre, une
longue gorge réfléchissante apporte à cette chambre un éclairage confortable.
La tête de lit, également en palmier, comporte des chevets, celui de gauche
étant composé d’étagères, et celui de droite d’un cabinet cubique servant de
support pour le téléphone, avec des casiers permettant de ranger quelques
livres.
Jean-François
Pinchon

Villa
Cavrois. Fauteuil en bois de palmier de la chambre des parents.
Collection
particulière / © ADAGP, 2004, Paris
VILLA CAVROIS,
LA SALLE DE BAINS DES PARENTS
L’appartement
des parents est complété par une très exceptionnelle salle de bains,
aujourd’hui anéantie. Le volume de la pièce, la sophistication des équipements,
le choix des matériaux, son esthétique moderniste en font un ensemble sans
équivalent, à une époque où ce type d’agencement retient toute l’attention des
architectes et des décorateurs et donne lieu à d’époustouflantes compositions,
tant en Europe qu’aux États-Unis. La presse ne s’y trompe pas, qui publie largement
les dessins et les photographies de cette salle de bains1.
Le
traitement du sol différencie les zones de ce vaste volume, qui occupe toute la
largeur de la villa – la zone réservée aux ablutions recevant un pavement de
marbre blanc tandis que celle dévolue aux soins de beauté et à l’habillement
est revêtue de moquette noire à pois blancs. Une simple marche et un meuble
architectonique en marbre et cuivre chromé, placé en épi, dissocient ces deux
zones. Dans la zone humide, une cabine de douche circulaire, aux dimensions
généreuses, occupe l’angle droit de la pièce. Revêtue, à l’extérieur, de marbre
blanc, et plaquée, à l’intérieur, d’émaux de Briare également blancs, elle est
fermée par une porte en verre incurvée. Une baignoire plaquée du même marbre
lui est accolée. À proximité, l’installation d’une balance a été
particulièrement étudiée. Son large cadran cerné de cuivre chromé a été intégré
à la cloison de la douche, et sa bascule dissimulée sous la moquette. Les
armoires de lavabos ont été réalisées, dans le même matériau, par les
établissements Anconetti. Au centre de la zone moquettée, une spectaculaire
table à étages en marbre blanc et à montants tubulaires en cuivre chromé,
longue de plus de trois mètres, permet de disposer ses effets personnels. Comme
les tabourets, inspirés d’un modèle de Pierre Chareau, les portes des placards
intégrés sont laquées blanc.
Située à
l’extrémité du bâtiment, cette salle de bains est baignée de lumière :
fenêtres d’angles, petites baies et portes vitrées l’éclairent sur trois côtés.
Par la croisée ouvrant sur un balcon, on a vue sur la piscine, en contrebas et,
au-delà, sur le parc.
Jean-François
Pinchon
15
SQUARE VERGENNES, MAISON ET ATELIER DU MAÎTRE-VERRIER BARILLET, PARIS,
1931-1932
Louis
Barillet abandonne en 1932 son atelier de la rue Alain-Chartier, devenu trop
exigu et incommode depuis que ses activités ont pris de l’ampleur, pour
s’installer au 15 square Vergennes, dans des locaux spacieux et fonctionnels
conçus par Mallet-Stevens. Ce projet s’inscrit tout naturellement dans la suite
d’une longue collaboration entre les deux hommes, amorcée au lendemain de la
Grande Guerre. L’exécution des vitraux et mosaïques s’incarne dans une suite
d’opérations précises et ordonnées qui aboutit à la production d’objets. Cette
suite logique conditionne l’établissement du programme. Au-delà du parti
fonctionnel, la construction exprime un double caractère symbolique. D’une
part, alors même que la construction se situe en période de crise économique,
elle manifeste la réussite sociale et financière de l’entreprise, alors à
l’apogée de sa notoriété. D’autre part, le choix de l’architecte proclame
l’engagement de son commanditaire dans le camp des modernes, celui de l’UAM.
Au
premier regard, l’omniprésence du verre sous toutes ses formes – vitrail,
verrière, fenêtres filantes – affirme l’importance extrême qui a été accordée
par l’architecte à la lumière. L’agencement des éléments constitutifs de
l’édifice traduit l’organisation fonctionnelle du plan1. Dans la
partie centrale du bâtiment, le rez-de-chaussée est consacré à l’atelier de
mosaïque et aux fours destinés à la cuisson des grisailles. Une large porte
permet le passage des livraisons de matériaux (verre, marbre), stockés dans la
réserve du sous-sol, et l’expédition des vitraux et des mosaïques terminés. En
étage, une immense verrière éclaire les espaces réservés au travail du
vitrail : au 1er, un atelier de découpe et de sertissage du
verre, et sur deux niveaux, aux 2e et 3e, les ateliers où
sont exécutés les dessins en vraie grandeur (cartons, choix des verres,
assemblage provisoire, peintures des grisailles) et où sont présentés les
vitraux, que l’on installe sur une armature réglable au devant de la verrière
pour juger par transparence de leurs effets plastiques. Une galerie en pourtour
de l’atelier, éclairée par la cour intérieure, abrite les services d’archives
et un laboratoire photographique. Les bureaux attenants aux ateliers sont
installés dans une aile courbe en saillie. Ateliers et bureaux sont réunis, à
chaque étage, par des vestibules donnant accès à l’ascenseur monte-charge et à
la cage d’escalier, dont l’éclairement est assuré par une étroite verrière
occupant toute la hauteur au-dessus de la porte d’entrée. Ce vitrail réalisé
dans la technique du «verre blanc» se signale comme une enseigne des activités
de l’atelier. En retrait derrière une terrasse, le dernier étage est réservé à
l’appartement du maître-verrier.
Afin
d’organiser les postes de travail, l’espace est libéré des structures porteuses
par l’emploi du béton armé, qui permet de concevoir des planchers lourdement
chargés sur des portées importantes. Les descentes de charges sont reportées au
maximum en périphérie de la construction, libérant ainsi de toute contrainte la
distribution des espaces. L’orientation de la façade principale au nord fournit
une lumière uniforme, favorable au travail du vitrail, mais pour répondre au
manque de clarté en fond d’atelier, Mallet-Stevens ménage une cour intérieure
mitoyenne au sud de la parcelle, qui lui offre la possibilité d’ouvrir des
fenêtres au sud et à l’ouest. De même, la partie en saillie correspondant aux
bureaux isole et protège la grande verrière de la façade principale des ombres
portées par le bâtiment mitoyen et procure aux bureaux une orientation à l’est.
L’inscription
du vitrail dans la façade illustre ce que Mallet-Stevens définit comme une
relation heureuse entre les deux disciplines : «Quand l’architecte voit
dans l’espace des volumes bien ordonnés, le peintre-verrier trace des lignes et
oppose des couleurs heureuses. Phénomène curieux que celui qui unit si
étroitement deux branches de l’art pourtant si différentes2.» Ce
vitrail au caractère monumental décrit les activités de l’atelier, dont chacune
est symbolisée par une ville emblématique : Chartres figure le vitrail,
personnifié par un souffleur de verre, Ravenne, la mosaïque, sous les traits de
l’impératrice Théodora, et Athènes (incarnée par la déesse Athéna), les
fondements de la culture occidentale. La représentation, qui mêle motifs
abstraits et figures géométrisées, joue sur la variété des verres industriels
imprimés, translucides ou noirs, opales, beiges et rosés, et des miroirs montés
double face. De ce fait, la paroi devient vivante : le vitrail se lit et
s’admire de l’intérieur comme de l’extérieur, de jour comme de nuit. «Il est du
reste fort captivant d’orchestrer ces réfractions et d’harmoniser dans cette
lumière blanche les subtilités de demi-teintes renforcées de valeurs qui nous
sont données par le miroir et qui peuvent aller jusqu’au noir pur3.» À
l’intérieur, Louis Barillet a installé entre l’atelier et le vestibule un autre
vitrail (une Histoire de Psyché4) traité dans un esprit plus
intimiste. Le travail de la mosaïque est également présent, avec un motif
décoratif sur les thèmes de la chasse ou de la nature, incrusté dans le
revêtement de sol en granito de chacun des paliers de vestibule. Par la
justesse des réponses qu’il donne à un programme très technique, Mallet-Stevens
offre à Louis Barillet plus qu’un simple atelier.

Maison
et atelier du Maître verrier Louis Barillet, 15 square de Vergennes, Paris,
1931-1932.
Photo
Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris
LA
CASERNE DE POMPIERS DE LA RUE MESNIL, PARIS, 1936
«Poste de
sapeurs-pompiers, par Mallet-Stevens : la rencontre peut paraître
singulière ; pour moi, je n’en tire point d’ironie ; j’estime
significatif, bien plutôt, qu’un des architectes qui appartient à notre gauche,
et à qui l’on a tant reproché ses tendances, vienne d’être demandé par une
ville pour élever un de ses bâtiments publics», écrit Emmanuel de Thubert dans
les colonnes de La Construction moderne1. La caserne de pompiers de la rue
Mesnil est effectivement la première commande publique qui échoit à
Mallet-Stevens2. Et le critique de Beaux-arts de
surenchérir : «Cet architecte a déposé là un excellent pavé dans la mare à
grenouilles de l’Administration. On l’en loue. Le temps était venu de donner
aux pompiers, munis de pompes automatiques et de voitures aérodynamiques, une
demeure digne des équipes actuelles. Mallet-Stevens l’a compris. Il a pensé que
les pompiers pouvaient, en somme, avoir une maison qui n’ait rien de pompier et
ne s’est point cru obligé de revêtir sa caserne de l’uniforme de laideur
officiel3.» Si le commentateur montre un tel
enthousiasme pour cette réalisation, c’est en raison de l’adéquation entre le
programme établi par le corps des sapeurs-pompiers et l’architecture
proposée : une organisation rationnelle malgré une parcelle en profondeur,
une esthétique nouvelle pour ce type d’équipement, moderne en ce qu’elle n’est
que fonctionnelle, pratique et efficace.
La
caserne regroupe trois entités : le poste de secours proprement dit, le
logement de la «troupe» et les appartements des ménages. Au rez-de-chaussée se
trouvent le garage des véhicules et, dans son prolongement, une cour et un
gymnase ; au 1er étage, donnant sur la rue, les bureaux des
officiers et le poste téléphonique. La troupe a son réfectoire à ce même étage
et ses dortoirs au deuxième. Les logements des familles sont, quant à eux,
répartis, à raison de quatre par étage, sur les niveaux supérieurs d’un
immeuble en «L» longeant la cour, depuis l’arrière de la parcelle jusqu’à la
rue. Trois entités, trois entrées distinctes sur la rue : au centre, les
grandes portes de la remise et, de part et d’autre, l’entrée de la troupe et
celle des appartements privatifs. La spécificité fonctionnelle devant être la
rapidité d’intervention, l’architecte a prévu des portes basculant
horizontalement, à commande électrique, une façade légèrement en retrait afin
de faciliter la manœuvre des véhicules – ceux--ci étant, de surcroît, placés au
plus près de la rue –, et une distribution des espaces permettant d’y parvenir
au plus vite. «Cette construction connaît la quatrième dimension : le
temps », écrit le critique de Beaux-Arts. L’édifice est aussi pourvu de
nombreux éléments de confort et de détails intérieurs qui innovent, pour ce
programme combinant espaces de travail et cadre de vie. Tous les appartements
ont un balcon, et la terrasse supérieure est aménagée pour les enfants. Les
différentes zones sont identifiées par leur couleur : le rouge pour la
partie technique, le gris et le blanc pour la troupe, et une couleur propre à
chaque étage des logements. Le béton de la façade a été bouchardé pour le
rendre plus agréable à l’œil. Les problèmes d’hygiène et d’entretien ont été
pensés d’emblée, d’où l’emploi abondant de carreaux vernissés blancs en revêtement,
et le soin apporté aux installations collectives. Dans un compte rendu des plus
exhaustifs, publié dans la revue belge La Technique des travaux4, Ch.
Roset, ingénieur des arts et manufactures, va jusqu’à relever un astucieux
dispositif pour maintenir les baies ouvertes sans battement, et conclut en
soulignant que la réalisation complète de l’immeuble n’a pas atteint le budget
prévu. Quant à L’Architecture d’aujourd’hui, elle offre à ses lecteurs,
à côté d’une présentation classique alliant texte descriptif et documents
graphiques, un reportage photographique inusité : une visite complète de
la caserne, à travers un kaléidoscope de vignettes5. Toutes
les revues ouvrent néanmoins sur la même photographie en hauteur de la façade
principale, où l’on peut reconnaître les signes les plus marquants de la
proposition de Mallet-Stevens : la silhouette du bloc technique, avec sa
grande baie filante, l’avancée du bâtiment en «L» sur la rue et ses balconnets
superposés en saillie, et, enfin, reliant les différentes parties de la
composition, une tour abritant l’escalier de secours de l’immeuble, dont le
dessin donne à l’ensemble son dynamisme, et à cet équipement son symbole.
Olivier
Cinqualbre

Caserne
de pompiers, rue Mesnil, Paris, 1936.
Photo
Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

Caserne
de pompiers, rue Mesnil, Paris, 1936. Entrées.
Cliché
Marc Vaux / Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, fonds Marc Vaux / © ADAGP,
2004, Paris

Caserne
de pompiers, rue Mesnil, Paris, 1936. Immeuble des ménages.
Cliché
Marc Vaux / Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, fonds Marc Vaux / © ADAGP,
2004, Paris
EXTRAIT
DE LA PUBLICATION
ROBERT
MALLET-STEVENS : L’ŒUVRE COMPLÈTE… À CE JOUR
Olivier
Cinqualbre
Vendredi
18 novembre 1938 : dans les salons de la société du Fibrociment de Poissy, rue Chaptal, à
Paris, d’éminentes personnalités de l’architecture participent à une soirée,
immortalisée par un photographe. Au centre d’un des clichés, Robert
Mallet-Stevens, entouré de Le Corbusier, à sa droite, et d’Auguste Perret, à sa
gauche1. Aux nœuds papillons très
professionnels de ses confrères, il a préféré une élégante cravate sombre.
L’ambiance est détendue et réunit pour un instant les trois ténors du mouvement
moderne français : Perret affiche une bonhomie de patriarche,
Mallet-Stevens fixe l’objectif et esquisse un sourire discret ; Le
Corbusier, le regard tourné vers lui, vient peut-être de lancer une des petites
phrases dont il a le secret, déclenchant ces réactions. Sur un tirage qui n’a
pas été recadré, on reconnaît dans l’assemblée André Bloc, Pierre Chareau et un
dernier personnage, sans doute M. Hugonnet, appartenant à la société invitante2. Sur un
autre cliché apparaît la vedette du jour, Édouard Menkès, qui vient de recevoir
le premier prix du 7e concours de L’Architecture d’aujourd’hui.
Cette
cérémonie et les photographies qui en témoignent fournissent plusieurs entrées
par lesquelles entamer un récit sur la carrière de Mallet-Stevens. Elles
montrent de manière éloquente sa place sur la scène architecturale, car, en
l’absence de quelques autres grands noms – dont Tony Garnier pour la génération
précédente et André Lurçat pour la sienne –, il occupe, ici et à ce moment, la
position véritable qui lui revient dans le mouvement moderne : celle d’un
de ses chefs de file et protagonistes de la première heure. […]
Mais ce
souvenir n’est qu’un prétexte qui nous permet d’expliciter le cadre de notre
travail. Car, au contraire de Le Corbusier et des frères Perret, Mallet-Stevens
n’a pas laissé de fonds d’archives. Cette absence explique en partie la rareté
des manifestations qui lui ont été consacrées. […]
Quant à
Mallet-Stevens, il était de notoriété publique que l’architecte avait décrété
la destruction de ses archives à sa disparition, mais nous ne pouvions nous
résoudre à une telle fin. Malheureusement, le premier résultat de notre travail
d’investigation fut la confirmation par un témoin de ce qui n’était jusque-là
qu’un récit familial7. Si cette volonté de ne pas laisser
de documents par devers lui est ainsi établie, on demeure néanmoins dans
l’ignorance de ses raisons : considérait-il que son œuvre bâtie – telle
que réalisée – était la seule qui méritât considération ? On n’a pas non
plus d’information sur le moment où le fait a été accompli – quelques années
plus tard, une fois écoulés les délais de rigueur pour des garanties
d’ouvrages, ou par nécessité de libérer les lieux8? Sans
doute, aussi, ne prêtait-on guère attention à ce type d’archives à l’époque, à
la sortie de la guerre, ce qui leur laissait peu de chances de survie.
Dès lors,
il ne restait plus qu’à mener notre enquête. À défaut d’un fonds constitué, il
fallait trouver d’autres sources, indirectes ou fragmentaires. Croiser les différentes
sources, publiques et privées, manuscrits et imprimés, photographies et
bâtiments.
Jusque
dans les années soixante-dix, les historiens étaient relativement démunis pour
retracer cette carrière. Ils disposaient de deux ouvrages : l’un édité par
Massin en 1930 – dont la préface et les multiples contributions cachent
difficilement le fait que la publication a été menée par l’architecte –,
l’autre signé par Léon Moussinac en 1931, les deux dressant une liste des
réalisations s’arrêtant à ces dates, malheureusement fort proches9.
D’articles parus dans des revues de l’époque. De notices nécrologiques, où
alternent hommages convenus et témoignages de sympathie. D’un ensemble de
dessins et de meubles donné en 1959 par Mme Mallet-Stevens au Musée des arts
décoratifs, et d’un autre acquis en 1978 par le Musée national d’art moderne.
D’un mémoire universitaire rédigé en 197410.
Ce sont
là toutes les sources que peuvent mobiliser, à la fin des années 1970, Hubert
Jeanneau et Dominique Deshoulières pour leurs recherches sur Mallet-Stevens,
dont résultera en 1980 un ouvrage édité avec Maurice Culot et Brigitte Buyssens
qui marque le premier jalon dans la reconnaissance contemporaine de
l’architecte11. Face à ces difficultés, ils sont
donc amenés à s’enquérir d’autres documents. On doit ainsi mettre à leur actif
la réapparition de ceux que conservait encore la famille – des dessins épars de
projets non réalisés, acquis depuis par le Musée national d’art moderne. Ils
ont en outre l’opportunité de bénéficier d’un gisement exceptionnel : le
fonds photographique conservé par Jean Nicolas12, dont on
ignore, par ailleurs, comment celui-ci en est devenu le dépositaire. L’origine
de ces tirages semble être la documentation même de l’agence. En effet, ce
fonds couvre la totalité de la carrière de l’architecte, depuis des maquettes
de projets non réalisés ou les interventions modestes sur des aménagements
intérieurs jusqu’aux œuvres majeures, et les mentions au dos des tirages sont
souvent de la main même de Mallet-Stevens. Il contient un nombre de documents
important (environ 200), mais cependant limité, ceux-ci paraissant avoir fait
l’objet d’une sélection, comme si Nicolas détenait des matériaux que des
proches auraient réunis dans la perspective d’une publication – qui, finalement,
ne verra pas le jour13 – au décès de Mallet-Stevens. Les
auteurs livrent une bibliographie amplement détaillée, qui fera longtemps
référence.
Le
deuxième temps de la reconnaissance correspond au centenaire de la naissance de
l’architecte. L’engouement commémoratif occasionne en 1986 la tenue d’une
exposition dans les salons de la mairie du XVIe arrondissement, avant un
périple à Villeneuve-d’Ascq, Bruxelles et Tours. Bien que les délais de
réalisation, très courts, ne permettent guère d’approfondir les recherches, la
nécessité même de présenter documents et objets contraint le commissaire,
Jean-François Pinchon, à entamer une prospection auprès de particuliers –
proches, collectionneurs et antiquaires –, et à réaliser un inventaire des
œuvres et archives conservées au sein des institutions publiques14. Ce
moment est également celui de la prise en considération de certains bâtiments
de Mallet-Stevens pour leur valeur patrimoniale, qui coïncide avec le lancement
par le ministère de la Culture, au printemps 1986, d’un programme d’action en
faveur du patrimoine du XXe siècle. Une monographie consacrée à la Villa
Noailles, à Hyères, fonde le socle historique d’un travail de restauration dont
le besoin se fait de plus en plus sentir, tandis qu’à l’autre extrémité de la
France, la Villa Cavrois, à Croix, est redécouverte par un
historien-journaliste-photographe : Pierre Joly15. […]
Pendant
les deux décennies qui nous séparent de cette dernière célébration, les
bâtiments ont rencontré des destins divers et des aléas parfois tragiques,
pendant que les meubles conçus pour eux suscitaient un emballement frénétique
du marché. La Villa Noailles a fait l’objet de campagnes de restauration,
longtemps avant que sa destination – un lieu culturel – ne soit solidement
établie. Le château de Mézy, passé entre les mains de plusieurs propriétaires
privés, qui affichèrent tous de grandes ambitions, n’en est pas moins resté
dans l’état de décrépitude qui était le sien au départ de sa dernière
habitante, Elvire Popesco. La Villa Cavrois a connu de multiples péripéties,
dues à sa cession par la famille et à la volonté des nouveaux propriétaires de
réaliser une opération immobilière, perspective à laquelle les pouvoirs publics
firent opposition. Le bâtiment subissant une lente et inexorable dégradation,
une association locale se mobilisa, et un classement d’office au titre des
monuments historiques intervint pour en assurer la protection, qui aboutit à
son acquisition par l’État en 2002. Aujourd’hui, la première tranche de travaux
pour sa remise en état est entamée. L’immeuble-atelier édifié pour le
maître-verrier Louis Barillet, square de Vergennes, a retrouvé fière allure
après une restauration bien menée. Transformé récemment en espace d’exposition,
il s’offre désormais à la visite.
Au-delà
de la réunion, pour la première fois, de tous les dessins subsistants, des
photographies anciennes, des meubles caractéristiques de la manière de
Mallet-Stevens, des archives cinématographiques, des maquettes produites pour
l’occasion, des reportages photographiques donnant à voir l’état actuel des
bâtiments, le propos de l’exposition a délibérément mis en avant le
professionnel – le grand professionnel – qu’il a été.
Il nous a
semblé que l’appréciation de l’œuvre de Mallet-Stevens souffrait de son image
de dandy de l’architecture moderne, d’architecte mondain. Nous nous sommes donc
attachés à retrouver, derrière cette silhouette, le créateur qu’il a été
pendant vingt ans. […]
Mallet-Stevens
a eu trois adresses professionnelles. Des vues intérieures nous renseignent sur
les deux dernières. Celle de la rue Vézelay, du début des années vingt, est
publiée pour sa décoration, celle de la rue Mallet-Stevens pour son
organisation16. C’est bien un outil de travail, où
sont reçus clients et entrepreneurs, où sont conçus projets et concours, plans
d’exécution et descriptifs d’ouvrages, où s’affaire le personnel de l’agence et
se croisent les collaborateurs extérieurs. Restituer autant que possible cette
activité, c’est s’intéresser en premier lieu à la production, ensuite aux
différents acteurs.
La
production : le terme réfère volontairement au monde de l’entreprise – il
s’agit du nombre d’affaires, des commandes, de ce qui fait «tourner la
boutique». Elle nous est connue par les listes de travaux dressées par
Mallet-Stevens, publiées dans les deux ouvrages de 1930 et 1931, et également
par quelques curriculum vitae manuscrits. Succincts, non datés, mais
vraisemblablement établis vers 193517, ceux-ci mentionnent avec
insistance les différentes sociétés auxquelles appartient l’architecte, les
nombreux articles («plus de cent dans les journaux et revues, français et
étrangers»), les participations aux salons et expositions, les conférences, les
décors de films. L’inventaire des édifices construits en France n’apporte pas
de révélation ; pour les autres pays, en revanche, en sus d’une «grande
villa» au Brésil, jamais localisée, et qui est devenue un mythe, s’ajoute une
villa à Westende, en Belgique, que nous n’avons pu identifier et qui en
deviendra peut-être un aussi. Pas de noms de clients, à de rares exceptions
près ; au mieux, leurs initiales. Pas de mentions de projets avortés, de
participations à des concours, d’études – hormis celles d’un building à New
York et de façades pour l’ambassade de Turquie à Téhéran. Malgré nos
recherches, ces villas et ces deux études n’ont pas pris plus de consistance.
Et que dire de la mention signalant «une cinquantaine d’installations
intérieures», dont on ne recense pas même la moitié aujourd’hui.
Mallet-Stevens
fut fait chevalier de la Légion d’honneur à la suite de l’exposition de 1925,
officier après celle de Bruxelles de 193517, mais son dossier ne nous renseigne
guère. Ces nominations ayant été accordées pour ses participations à des
expositions internationales, seule la rubrique afférante a été
consciencieusement remplie. Et lorsqu’il est nommé directeur de l’École des
beaux-arts de Lille, en 1935, son dossier personnel ne compte aucune pièce
relative à sa carrière.
Si
incomplète soit-elle, la liste des études et réalisations jusqu’au tournant des
années trente fait apparaître en comparaison la période suivante comme
désespérément vide de travaux et de concrétisations, à l’exception de
l’intermède de l’exposition de 1937. Le contexte difficile, les effets de la
crise économique, la raréfaction de la commande privée et la relance publique
rare, quand elle n’est pas tout simplement absente, l’expliquent. On était
informé par quelques articles de la participation de Mallet-Stevens à des
concours, mais on peut désormais mesurer à quel point il a été contraint de
procéder à une réorientation de son activité, en répondant à des sollicitations
plus ou moins formalisées ou en soumettant des propositions de sa propre
initiative, qui ne déboucheront sur aucun chantier. À cette fin, il s’associe,
et c’est dans les archives de ses partenaires que l’on peut trouver quelques
esquisses et rendus de ces projets18.
C’est le
cas du Musée de la République avec Jacques Carlu, du concours des deux musées
d’art moderne, de la proposition d’un stade olympique, et d’une étude inédite
pour une Maison de la Radio avec Georges-Henri Pingusson. […] Des projets
inconnus surgissent, d’autres prennent corps, grâce à la découverte d’originaux
ou à une meilleure identification […].
D’autres
fonds de collaborateurs, même extrêmement lacunaires, vont venir nourrir notre
connaissance. Celui d’André Salomon est de ceux-là19. Dès que
leur relation est établie, il devient l’éclairagiste de Mallet-Stevens :
le seul avec lequel il travaillera. Ses archives photographiques font ressortir
nombre de réalisations communes, en particulier les façades de magasins –
celles de Bally et des Cafés du Brésil, notamment –, les aménagements de
bureaux et de salles de réunions pour des sociétés commerciales et bancaires,
les intérieurs de certaines habitations. Mais toute découverte de documents, si
elle vient pallier pour partie l’absence première, rend d’autant plus patente
l’étendue de nos manques. […]
Parmi les
artistes avec lesquels travaillera l’architecte tout au long de sa carrière,
une place particulière revient aux frères Martel, Jan et Joël, sculpteurs, et à
Louis Barillet, maître-verrier. Leurs créations respectives accompagnent son
œuvre […]. Ils ont par ailleurs en commun d’avoir compté parmi les clients de
Mallet-Stevens. Si les archives de Barillet et de ses collaborateurs, Jacques
Le Chevallier et Théodore Hanssen, ne recèlent pas d’informations sur leur
collaboration avec l’architecte, celles des frères Martel ont été, en
contrepartie, d’un apport considérable20. Mais ce n’est pas tant, pour ces
dernières, la part professionnelle que personnelle qui s’est avérée
particulièrement précieuse. […] En revanche, les archives les concernant en
tant que clients de l’architecte sont particulièrement riches en photographies
anciennes, croquis divers, correspondances et factures, preuve, s’il en était
nécessaire, de leur implication dans l’opération de leur maison-atelier de la
rue Mallet-Stevens. Plus encore, c’est dans une chemise afférente à cette construction
qu’ont été retrouvées les esquisses pour le bâtiment manquant de ladite rue,
celui qui avait été imaginé face à l’hôtel personnel de l’architecte.
Un autre
fonds présente également un grand intérêt, plus pour son apport en informations
qu’en documents originaux : celui d’Édouard Menkès21. […]
Durant toute la décennie trente – du concours de l’étude architecturale pour la
place de la Victoire jusqu’aux pavillons de l’Exposition de 1937 – il fut,
auprès de Mallet-Stevens, le perspectiviste, l’homme des rendus. Dessinateur de
génie, il cède son style graphique à la production de l’agence : son coup
de patte est si caractéristique qu’il est immédiatement identifiable. Ceci
permet d’attribuer à Menkès la plupart des dessins qui, en raison de leurs qualités
plastiques, ont été préservés. Formé à Vienne, il vient prolonger, d’une
certaine manière, la sensibilité viennoise de Mallet-Stevens.
[…]
Des
débuts de Mallet-Stevens, depuis sa formation à l’École spéciale d’architecture
jusqu’à ses premiers édifices, soit près de quinze ans de sa vie, on ne savait,
jusqu’à présent, que très peu. On lui connaissait quelques articles signés dans
des revues belges. Il est en fait prolixe : dès sa sortie de l’école, il
multiplie les interventions dans la presse, et tient pour certains supports de
véritables chroniques. Et dans celles-ci, il ne se contente pas de rapporter
l’actualité parisienne des salons ou des «nouveautés» : il entame un
travail de critique et présente l’actualité architecturale internationale, des
bâtiments de Perret aux constructions d’Eliel Saarinen ou de Louis Bonnier.
Ses
premiers travaux sont marqués par le style viennois, aussi bien dans la
représentation graphique que dans le vocabulaire architectural. Certains ont
d’ailleurs parlé à leur sujet d’immaturité, d’œuvre sous influence, voire de
plagiat. Il faut y voir, bien au contraire, un cheminement des plus originaux,
puisqu’il apparaît comme un élève de Josef Hoffmann sans être passé par son
enseignement, et l’unique représentant de cette école en France. On pouvait
subodorer que le lien familial qui l’unissait aux Stoclet, les commanditaires
du fameux palais de Bruxelles, l’avait conduit à fréquenter ce chantier et à en
apprécier le résultat : la découverte d’un article dont nous avons pu lui
attribuer la paternité confirme l’importance de cette réalisation dans sa
formation.
Une autre
originalité du parcours de Mallet-Stevens est sa pratique de décorateur de
films et sa curiosité pour l’art cinématographique, dont on peut se demander
quelle est celle qui fonde l’autre, mais dont on pressent qu’elles
s’entretiennent mutuellement. Ce dont on est sûr, c’est que cette activité
constitue pour lui, après les cours de l’école, après les leçons
journalistiques puisées dans l’architecture en train de se faire, le troisième
et dernier pilier de sa formation. Or, autant les deux premières voies sont
traditionnelles, autant la troisième est tellement singulière qu’elle interdit
à qui l’ignore de prendre la pleine mesure de l’œuvre de Mallet-Stevens. Au
début des années vingt, en très peu de temps, la quantité de films dont il
réalise en partie les décors et l’activité théorique qu’il déploie en la
matière – écrits, entretiens, expositions – en font une figure à part dans le
panorama français de l’époque. Il est parmi les décorateurs de films un des
rares architectes, et parmi les architectes un des rares à se livrer à cet
exercice. Et auprès de ceux qui, parmi ces derniers, s’y essayent, il est le
seul à pouvoir compter un tel nombre de films à son actif. Entre les décors
historiques et les intérieurs modernisants, les agencements classiques et les
architectures avant-gardistes des films de L’Herbier, Mallet-Stevens aura su
puiser dans ce domaine un enseignement précieux concernant l’espace et sa
perception, les volumes et leur éclairage.
C’est
cette recherche qui fonde son architecture et explique sans doute la faible
place accordée à la dimension constructive : celle-ci n’est là que pour
servir. L’emploi du béton armé autorise une grande portée et une surface au sol
dégagée : il est utilisé à cet effet, revendiqué comme tel, mais jamais
employé pour sa qualité de matériau moderne. Devant la réalité du chantier, le
pragmatisme l’emporte. Les volumes souhaités étant obtenus, c’est aux éléments
de second œuvre et à l’équipement technique qu’il attache de l’importance.
Mallet-Stevens ne peut soutenir la comparaison avec Perret, le
constructeur ; il ne peut pas plus rivaliser avec Le Corbusier, le
théoricien et le polémiste. Son combat, il le forge dans une pratique collective.
On savait Mallet-Stevens enclin à inviter ses confrères à apporter leur propre
sensibilité dans les intérieurs de ses clients ; on le savait également
prédisposé à s’entourer de créateurs : Barillet, Prouvé, Salomon, les
frères Martel… À voir combien ces principes sont chez lui systématiques, et ce,
tout au long de sa carrière, on constate à quel point cette attitude relève
autant de l’éthique que de la recherche de l’excellence.
On
connaissait Mallet-Stevens, fondateur de l’UAM, membre éminent de
l’association, participant à toutes les expériences collectives d’aménagement
intérieur (tels les locaux de La Semaine de Paris) ou d’industrialisation (le
mobilier scolaire ou les cabines de paquebot à l’initiative de l’OTUA). On
découvre un chef de mouvement qui, devenu directeur de l’École des beaux-arts
de Lille, va tenter de transformer en enseignement les velléités d’un
manifeste, de constituer en école ce qui n’était alors qu’un rassemblement de
compétences ne trouvant à s’exprimer que par le biais de manifestations, par
nature éphémères.
Quand il
ne met pas en avant ses amis créateurs, l’architecte se charge lui-même de
dessiner des meubles et de les affecter aux intérieurs et villas qu’il aménage.
C’est du sur mesure, loin de la petite série vendue en boutique comme dans le
cas de Pierre Chareau, encore plus loin de la diffusion des modèles par la
firme Thonet ou l’éditeur Stylclair. Faute d’informations substantielles, on
demeure dans le vague : la disparition des archives de l’agence, conjuguée
à celle des entreprises, rend opaque tout ce pan de son activité. Demeurent des
descriptions, des mentions des matières et des coloris employés, qui méritent
d’être relevées chaque fois que possible, pour rompre avec la vision
photographique en noir et blanc. Subsistent également quelques meubles,
aujourd’hui collectionnés et par là sauvés de la destruction et de l’oubli, qui
témoignent de ses recherches esthétiques et nous font regretter que n’ait pu
être conservée dans son intégrité bâtie, décorée et meublée, la villa Cavrois.
De toute une production sortie de l’agence, mise au point avec des artisans et
des industriels, nous ne possédons qu’un unique dessin signé de sa main, qui,
pour symbolique qu’il soit – il s’agit d’une variante de sa chaise métallique –
ne saurait pallier de telles lacunes.
À ce
stade de la réflexion, il est permis de se demander s’il n’était pas
présomptueux de songer à établir un catalogue de l’œuvre complète, et audacieux
d’affirmer y être parvenus. Nous sommes conscients de ce qui nous échappe et
qui restera peut-être à tout jamais enfoui. Peut-être était-ce là le destin de
l’œuvre de Mallet-Stevens ?
Peut-être
devrions-nous convenir que notre quête était une tentation démesurée, à
laquelle nous avons succombé avec empressement, comme nos prédécesseurs, et
comme, nous l’espérons, d’autres à notre suite. Car, sans doute, de nouveaux
documents et témoignages surgiront après notre travail, peut-être même dans
l’effervescence de l’exposition. Complète, l’œuvre de Mallet-Stevens l’est… à ce
jour.
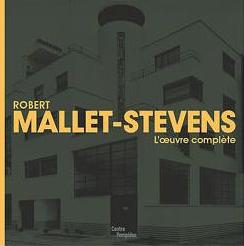
Robert Mallet-Stevens,
L’œuvre complète
sous la direction d’Olivier Cinqualbre
Edition du Centre Pompidou, Collection Classiques du XXe siècle
Format 28 x 28 cm, 240
pages, 400 ill. noir et blanc et couleurs
ISBN : 2-84426-270-8 - Prix :
39,90 €
Catalogue de
l’exposition
« Robert Mallet-Stevens, architecte »,
présentée du 27 avril au 29 août 2005 au Centre Pompidou